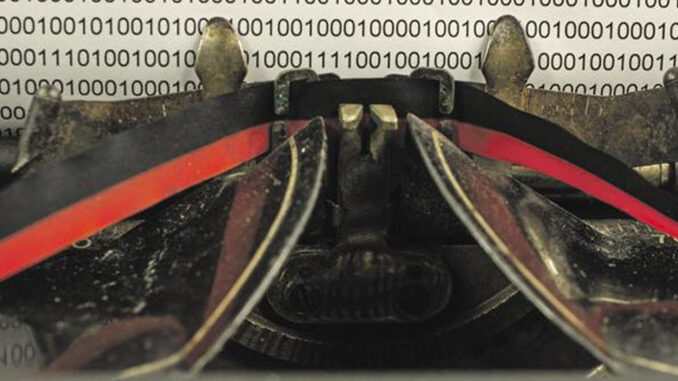
Voilà donc le journalisme attaqué, insulté, menacé. L’invective et le poing, en pleine face. De la part de ceux pour qui la démocratie est une horreur, rien d’étonnant. Et rappelons-le, cette violence exercée à l’encontre des journalistes est injustifiable. Mais pour tous les autres, ceux qui font entendre cette colère qui confine à la défiance, au rejet ? Impossible de ne pas les entendre, de ne pas prendre en compte. Alors, le journalisme tente de répondre, comme il le peut : analyses du phénomène, déclaration de bonne foi, d’indépendance ou aveux d’erreurs… Au même moment, comme un couperet sans appel, tombent les chiffres d’une confiance plus que jamais en berne entre les médias et leur public (cf. la Croix). Bref, la crise est bien là avec un journalisme globalement sommé de se poser la question de sa qualité. Qu’entend-on par-là ? C’est par définition, examiner sa production, ses contenus. Autrement dit, ce que le journalisme «représente». A l’instar de la «démocratie représentative» qui est aujourd’hui elle aussi bousculée. Juste retour des choses, pourrait-on dire, puisque le journalisme affirme en être l’un des piliers. Alors, que «représente» l’information ? A priori, les réponses sont multiples : des femmes, des hommes, la vie, des histoires, etc. Soit, mais à cette question, le journalisme possède ses propres réponses. Il «représente» ce qui l’actionne, le déclenche. A savoir, l’événement comme on disait naguère, ou pour utiliser un vocable plus contemporain, le fait. Précisément, ce dernier est au cœur de la crise actuelle du journalisme. Son altération concentre toutes les attentions, politiques ou professionnelles. Entre infox,fake news ou fausse nouvelle, la difficulté de lui trouver une juste appellation en dit long sur la complexité du sujet. Toujours est-il que le service public comme les médias privés, chacun est désormais à l’ouvrage pour déclarer à la contrefaçon une guerre salutaire. Comme une remise à jour du vieux mantra du journalisme américain, «facts only facts». Mais justement, le journalisme n’a pas toujours représenté les mêmes faits. Car le fait est d’abord le fruit d’un discours. Il est une production. Au fil du temps, ces «facts» ont changé de nature si l’on peut ainsi dire. Il ne s’agit pas de la description forcément changeante de la réalité en mouvement, mais plutôt du regard journalistique en soi, et, plus précisément, de ce qui mérite selon lui, d’être «traité». Bref, d’évoquer une histoire de l’information dans ses procédures. Voici à grands traits, cette tentative.
On le sait, longtemps, le fait fut celui du prince, au plein sens du terme. La Gazette de ce cher Théophraste informait aussi sur les activités de la Cour, politique intérieure, mais aussi diplomatie. A noter que Renaudot, son concepteur, souhaitait déjà empêcher «les faux bruits qui servent souvent d’allumettes aux mouvements et séditions intestines».
Dans notre rapide survol, il y a après la Révolution de 1789, le «fait» devenu une conviction politique, artistique. Le Journal des débats s’affichait par définition comme une enceinte de débats rageurs entre opposants résolus. Cela avait incontestablement du style. Celui d’une élite qui vivait au rythme des polémiques du moment. Les traces en demeurent encore profondes dans notre culture actuelle des échanges politiques.
On imagine, au XIXe siècle, la tête des inconditionnels de la querelle, quand ils virent l’apparition d’une presse nouvelle, avec cette fois, le Petit Journal. Là encore, l’heure était aux soubresauts politiques, printemps des peuples, Commune de Paris… Aux yeux des tenants de l’ancien monde, on se roulait maintenant dans la boue du crime sanglant. Le «petit» reporter était pour eux, un vautour prêt à tout pour faire vendre… «Le fait» venait de se transformer. Le journalisme d’information était né. Le succès était énorme. Avec l’enquête comme pratique quotidienne – grande pourfendeuse des injustices sociales – et le reporter comme personnage central, cette presse nouvelle avait su conquérir la confiance du public. Mais très vite, les scandales financiers se sont succédé, l’absolue confusion entre politiques et journalistes jetait le trouble, l’antisémitisme d’alors permit tous les excès. La Première Guerre mondiale avec censures et bourrage de crâne acheva de saper la crédibilité des journalistes. Il fallait réagir. Pour préserver le rôle d’une corporation en péril, quelques journalistes rédigèrent une charte déontologique en 1918. Le «fait», rapporté par la presse trouvait sa réhabilitation dans le cadre de droits et devoirs s’appliquant au journalisme «digne de ce nom». Bien sûr, les sciences exactes, humaines ou sociales n’ont pas manqué d’influencer fortement le journalisme. A n’en pas douter, le développement de la statistique, comme outil de gouvernement, fut majeur dans la redéfinition des «faits». Le reporter d’antan allait sur les lieux de l’événement tragique, pour témoigner. Le journaliste du nombre, lui, dès les années 60, examine la fréquence de faits qualifiés de semblables. Il les rassemble dans une même catégorie. Le fait de société est né ainsi. Et ce fait-là n’est pas le fait divers. L’un est singulier, l’autre est général. Il a pour noms, «la» sécurité, «la» consommation, «la» jeunesse… Car le «fait» statistique nouveau est inépuisable. Insensiblement, à la télévision, la représentation des faits par les images a alors puissamment changé le «donner à voir» de l’info. Désormais, les tournages ne racontaient plus une histoire, ils «illustraient» la problématique du jour. Surtout, ce fut l’arrivée massive de l’expert, qui vint, et vient encore aujourd’hui apporter son savoir à la compréhension du sujet. Avons-nous alors laissé s’installer une distance coûteuse avec le public ? Et cela dans les mots utilisés, comme dans les images montrées ? Ces «faits», sont-ils ceux qui font dire encore aujourd’hui à nombre de personnes qu’elles ne s’y reconnaissent pas ?
En tout cas, les usages numériques sont venus bousculer la donne. Pour la première fois dans la petite histoire des médias, c’est la base qui s’est retrouvée en mesure de produire des textes, des sons, des images, en temps réel et sur toute la planète. Via les réseaux sociaux, les mass media se sont vus résumés à l’échelle de chacun. Une nouvelle génération de «faits» singuliers est ainsi apparue. Dans le même temps, la presse procède à l’analyse de ces «faits nouveaux», devenus data, cette fois envisagés sous leur angle massif. De quoi mieux comprendre les sociétés contemporaines, sans pour autant apercevoir le Brexit ou l’arrivée de Donald Trump.
Accepter qu’il y a bel et bien une histoire du «fait», c’est poser le principe de sa complexité, et du pouvoir qu’il y a à énoncer, à valider, la véracité des énoncés. Ainsi, armé de son histoire, «le fait» peut être défini comme évolutif et non «alternatif». Le fait est également sédimentaire : le reporter coexiste avec le data-journaliste. Cette histoire constitue un enjeu majeur car c’est elle qui a forgé toute la valeur donnée au «fait». Elle se doit donc d’être enseignée sous la forme d’une discipline pleine et entière. En effet, l’implication de l’information via le numérique dans la vie de toutes et tous, particulièrement dès le plus jeune âge est désormais omniprésente. Ce simple constat nous impose de constituer le corpus indispensable pour l’éducation à cette matière, à la fois nouvelle et ancienne qu’est l’information. La nécessaire chasse à l’infox n’est qu’un élément parmi d’autres. A titre d’exemple, la connaissance approfondie des faussaires n’a pas remplacé l’enseignement de la peinture. Certes, des institutions, des initiatives existent d’ores et déjà pour vivre «en société médiatique». Elles sont toutes remarquables. Mais la discipline à construire appelle à plus encore. Si l’on osait le cliché de presse, on dirait qu’il y a là, une urgence politique.