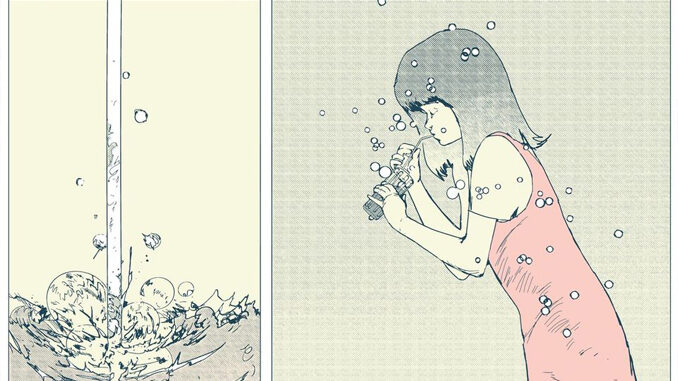
Difficile de trouver plus insaisissable que le vide, un mot des plus communs qui se dérobe à toute définition précise dès lors qu’on cherche à le cerner de trop près. Peut-on, d’ailleurs, vraiment cerner le vide ? Dans son essai Ce qui est sans être tout à fait, Etienne Klein a voulu l’attaquer sur tous les fronts, depuis les philosophes présocratiques jusqu’aux vides quantique et relativiste, en passant par Galilée, le vide des alpinistes et celui de l’ennui. Figure française de la vulgarisation scientifique, le physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en philosophie des sciences a su trouver les mots, ces mots qu’il ne cesse d’interroger, de disséquer, pour nous placer au bord du vide. On a eu le vertige.
L’histoire du vide démarre mal. On a d’abord nié jusqu’à son existence…
Absolument, avec des arguments de logique, des arguments qui viennent de l’interprétation de l’observation. Aristote, comme souvent, a fait autorité. Il explique que si le vide existe alors le mouvement est impossible, selon sa propre théorie du mouvement. Alors que pour les atomistes, comme Démocrite, il n’y a pas de mouvement sans vide : il faut qu’il existe un espace vide pour pouvoir accueillir le déplacement des objets. Mais attention, on rétroprojette souvent le sens des mots d’aujourd’hui sur ce que pensaient les anciens, ce qui crée des malentendus. Quand on regarde les fragments grecs de Démocrite, on s’aperçoit qu’il n’utilise pas le mot «vide». Il utilise «mèden», qui veut dire «non-être». Pour lui, l’être et le non-être coexistent, ils forment les deux faces du réel. C’est Aristote que va traduire «mèden» par «kénon», qui veut dire vide.
Et les débats ne seront pas tranchés pendant plusieurs siècles. Distinguer la notion de vide de celle de néant ou de non-être, c’est très compliqué. Dire que le vide est associé à une dimensionnalité spatiale que n’a pas le néant, ça ne se fait pas comme ça. On trouve un texte de Léonard de Vinci à ce sujet à la fin du XVe siècle. Ça veut dire qu’à son époque, il y avait toujours des discussions.
Encore aujourd’hui, opérer une distinction entre le vide et le néant n’a rien d’immédiat…
Il faut reprendre la définition : le vide, c’est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Parce que si le vide n’est pas le néant, on ne peut pas tout retirer. On voit bien qu’il est difficile de s’en sortir en se contentant des définitions.
D’où vient ce mythe que la nature a horreur du vide ?
D’abord de l’observation, par exemple qu’il est difficile d’écarter deux surfaces lisses plaquées l’une contre l’autre. Au Moyen Age, c’est interprété comme une force, un sentiment de la nature, qui agit sur les phénomènes. Je pense qu’on n’a pas vraiment rompu avec cette croyance. Il suffit de demander autour de vous : qu’est-ce qui se passe quand on aspire le jus d’orange avec une paille ? On est tellement habitué au phénomène qu’on n’y prête plus attention. On aspire de l’air, et ça fait monter un liquide. Si on demande à des mômes en primaire, ils imaginent comme des petits crochets entre l’air et le liquide. C’est l’idée que l’aspiration fait monter l’air et que le liquide suit le mouvement. D’autres disent qu’on crée du vide et que la nature remplit le vide avec ce qu’elle peut, donc le liquide.
Et pourtant…
Et pourtant, c’est bien la pression atmosphérique qui appuie sur le liquide dans le verre et qui fait monter celui dans la paille qui a subi une dépression avec l’aspiration de l’air. C’est ce qu’ont montré Galilée et Torricelli au milieu du XVIIe siècle à partir d’un problème constaté dans les fontaines de Florence : les pompes n’arrivaient pas à faire monter l’eau de l’Arno lorsqu’elle se situait à plus de 10 mètres en contrebas. Et, en remplaçant l’eau par du mercure dans une expérience avec un tube d’un mètre, Torricelli obtient, en haut du tube, un espace avec du vide.
Même lorsqu’il est observé par l’expérience de Torricelli, certains contestent encore l’existence de ce vide ?
Oui, car il y avait des arguments théoriques pour dire qu’il ne pouvait pas exister, notamment ceux d’Aristote, mais aussi ceux de la théologie : Dieu ne peut pas avoir créé un espace vide car Dieu ne fait rien qui soit inutile. Mais ce qui est remarquable, c’est que la controverse n’a pas duré longtemps. En dix ans, c’est réglé. Une question incroyable qui a alimenté des discussions pendant des siècles est close par une expérience. Cet événement coupe l’histoire en deux et c’est cette rupture-là qui va permettre ensuite de mettre sur pied la physique moderne. D’autant que Galilée avait déjà envisagé le vide comme possibilité théorique, en expliquant que «dans le vide», les lois du mouvement seraient plus simples pour aboutir à ce qu’on connaît sur la chute des corps.
Qu’est-ce que le vide, donc ?
Pour définir le vide, il faut définir un mobilier ontologique et, le vide, c’est ce qui reste quand on enlève ce que la théorie dit qu’on peut enlever.
C’est-à-dire ?
Si vous êtes en physique classique, celle de Newton, disons, il y a trois sortes d’entités posées par la théorie : l’espace, le temps et les objets, les points matériels. Eh bien, le vide, c’est ce qui reste quand vous avez enlevé les points matériels. Il reste donc l’espace vide et le temps. C’est le vide classique. C’est une idéalité. On ne peut jamais le réaliser, il y a toujours un petit atome qui traîne, et même si on retire les atomes, il reste le champ électromagnétique du fond diffus cosmologique. Il n’est jamais complètement vide. Ce qui est fascinant, c’est que la physique contemporaine met en scène autant de vides différents qu’elle a de théories. Et aujourd’hui, il y en a deux principales : la physique quantique et la relativité générale. Chacune a son vide, et ce ne sont pas les mêmes. Question : est-ce que deux vides peuvent cohabiter dans l’univers ? Si la réponse est oui, c’est que l’un des deux vides contient l’autre, il n’est donc pas vide.
On en vient presque à faire du Raymond Devos, non parce que la situation est loufoque, mais parce que nous n’avons pas suffisamment réinterrogé la façon dont les mots, au cours des avancées scientifiques, devraient s’adapter. Lorsqu’il y a une révolution dans la science, on la dit avec les mots de la théorie qui vient d’être remplacée. On réhabilite et on réinvestit des mots de l’ancien monde dans le nouveau monde. On garantit ainsi une fixité sémantique alors que les signifiés ont subi des métamorphoses radicales.
Vous citez Lavoisier, l’inventeur de la chimie moderne, qui explique qu’il faudrait mettre à jour le langage en fonction des découvertes scientifiques. Mais ne perdrait-on pas alors l’émerveillement lié à cette polysémie qui ne cesse d’interroger lorsqu’on parle de l’espace, du vide ou du temps ?
C’est une très bonne question, mais comment répondre ? En effet, si on effectuait ce que Paul Valéry appelait un «nettoyage de la situation verbale», pour clarifier les choses et avoir un langage qui soit isomorphe à nos connaissances, on perdrait le vertige, on perdrait ce qui fait le charme du langage : le second degré, le double sens… On perdrait peut-être l’humour. On perdrait peut-être la poésie. Mais on gagnerait en sécheresse et en compréhension.
Si j’ai cessé de m’intéresser à la situation du temps, c’est simplement parce que je n’en peux plus du fait que des gens de différentes disciplines utilisent le même mot pour désigner des choses différentes. Par exemple, quand on entend un physicien dire «le temps n’existe pas», de quoi parle-t-il ? S’il ne le dit pas, cette phrase devient complètement arbitraire. Si je dis «Dieu n’existe pas», c’est intéressant, mais tant que je n’ai pas précisé ce que j’entends par le mot «Dieu», je n’ai rien dit. Pour dire que le temps n’existe pas, ça demande donc de dire précisément ce qu’est le temps – ce qui est difficile -, surtout si on suppose qu’il n’existe pas.
Comment bien définir ce qui n’existe pas ? On doit périodiquement faire l’exercice de dire de quoi l’on parle quand on parle.
N’est-ce pas central dans l’exercice de la vulgarisation ?
Absolument. Je pense qu’un vulgarisateur, et je revendique le terme, est quelqu’un qui doit en passer par s’interroger sur le langage.
Faire de la vulgarisation, finalement, c’est, comme le disait Wittgenstein, faire une critique du langage en utilisant comme base théorique les connaissances scientifiques. Les connaissances obligent, pour être dites par le langage, à critiquer ce dernier, à presque inventer une langue étrangère dans la langue pour dire la nouveauté qui vient des connaissances. Le langage ordinaire ne contient pas déjà la science et notre langue quotidienne ne dit pas la connaissance scientifique. On a du coup deux solutions : soit on simplifie la connaissance pour qu’elle corresponde au langage mais, à mon avis, dans tous les cas, on finit par la perdre, soit on clarifie la connaissance puis on critique le langage pour arriver à créer de nouveaux espaces langagiers.
Est-ce que vous considérez qu’il est nécessaire d’avoir une culture générale scientifique minimale pour être un citoyen éveillé ?
Non. Je n’ai pas une conception scolaire de la démocratie. On a le droit d’être indifférent à la science. On a le droit de ne pas s’y intéresser. En revanche, je pense qu’on doit garantir une libre circulation des connaissances, notamment scientifiques. Ça suppose donc qu’elles soient émises et que dans leur propagation, elles ne soient pas trop déformées. Et ça suppose aussi qu’on sache tous, en tant que citoyens, faire la différence entre les croyances et les connaissances. Des croyances, j’en ai, tout le monde en a, et je ne parle pas seulement de la religion. Mais nous avons des connaissances qui se sont émancipées statutairement des croyances dans l’histoire des idées. Elles ont été démontrées comme connaissances. Ça ne veut pas dire qu’elles sont absolument vraies, mais ça leur donne une certaine dignité qui les rend redevables d’être vulgarisées. Mon travail, c’est d’émettre des connaissances dans une forme telle qu’elles puissent être diffusées sans trop de déformation.
Après la matière, le temps, le vide, vous reste-t-il encore des territoires aussi féconds à explorer ?
En ce qui concerne les grands concepts de la physique, j’ai l’impression d’en avoir fait un peu le tour. Ceci dit, on peut avoir l’impression d’avoir épuisé un sujet et finalement y revenir. Je l’ai fait deux ou trois fois avec le temps. La force de rappel du vide me ramènera peut-être à lui. Mais il y a un autre terme que j’aimerais approfondir. Il ne fait pas partie du vocabulaire de la physique à proprement parler, mais il fait partie de celui de la science. Il revêt des sens très différents selon les disciplines, même au sein d’une même discipline. C’est le mot «expliquer». Qu’est-ce que ça veut dire, expliquer.
Quand je dis que j’ai expliqué un phénomène, ça veut dire quoi ? Pour un physicien ? Pour un biologiste ? Expliquer, est-ce la même chose que comprendre ? Est-ce que c’est le fait d’avoir une certaine compréhension qui permet d’expliquer à l’autre ?