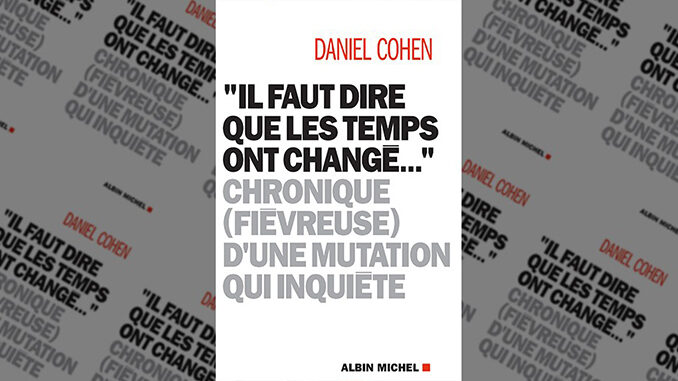
Daniel Cohen est un homme de plus en plus inquiet. Déjà, dans ses derniers livres, l’appréhension dominait, qu’il s’agisse de l’environnement ou des inégalités. En 2018, c’est l’ascension des populistes et la société qui sortira du nouvel âge digital qu’il décortique et redoute. Car, comme le philosophe italien Antonio Gramsci l’écrivait depuis les prisons mussoliniennes au début des années 1930, « le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Mais, si Daniel Cohen n’est pas particulièrement optimiste , il ne tombe jamais dans ces travers contemporains que sont le catastrophisme et la dépression. La fin d’un monde n’est pas nécessairement celle du monde. L’important reste de comprendre.
« L’effondrement de la civilisation industrielle »
Le professeur qui a formé une génération d’économistes français à Normale sup et Polytechnique revisite l’histoire des pays développés depuis les années 1960 avec la clarté qui caractérise ses écrits. Il nous raconte l’histoire de l’effondrement de « la civilisation industrielle » et l’entrée dans une nouvelle ère, celle de l’homme digital, qui pose plus de questions qu’elle n’offre de réponse. Le tout, en convoquant des sociologues, historiens, politologues de toutes les tendances.
La fin de la croissance
Au départ était mai 1968, cette « fête joyeuse où aucune tête ne fut coupée » et où la société occidentale se retrouve sous le feu des critiques. D’un côté, la jeunesse dénonce l’aliénation, la consommation et les conventions hypocrites d’une société bourgeoise. De l’autre, elle attaque l’exploitation économique et le travail à la chaîne. Mais l’utopie gauchiste échoue en se fracassant sur la demande latente d’individualisme. Sans compter que l’économie s’en mêle : 1968 marque en fait le début de la fin de l’industrie dans la majorité des pays développés ainsi que la fin de la croissance forte. Or, cette progression de la richesse était en elle-même une forme de redistribution. Avec le déclin de l’industrie, c’est aussi « une société liant, de manière rigide mais solidaire, les dirigeants d’entreprise et les ouvriers à la chaîne, en passant par les ingénieurs et les contremaîtres », qui disparaît, nous explique Daniel Cohen. Mais, citant André Gorz, le penseur de l’écologie politique, il rappelle que « la crise des systèmes industriels n’annonce aucun monde nouveau. Aucun dépassement salvateur n’y est inscrit ».
L’échec de la contre-révolution conservatrice
Au crépuscule des années 1970, l’heure de la contre-révolution conservatrice de Reagan et Thatcher, et du nouvel esprit du capitalisme qu’elle véhicule, est venue. C’est l’alliance des cols bleus et de Wall Street autour d’une valeur simple – le travail est salvateur – et d’une idée, elle aussi, simple : une exigence morale retrouvée suffirait à ce que le capitalisme s’auto-régule. Nouvel échec. Le capitalisme actionnarial, le recul de l’Etat, le culte de la performance, l’externalisation à tout-va, la mise en concurrence des prolétariats du monde entier avec la mondialisation ont entraîné une explosion des inégalités sur le plan économique et le triomphe de la cupidité des dirigeants sur le plan moral. Et in fine, la crise de 2008. Les classes populaires en prennent acte : « La gauche a échoué à les protéger de la crise […] et la droite, élue sur un programme de restauration morale, les a sacrifiées sur l’autel de la cupidité. » La voie est ouverte pour les populistes. Orbán, Salvini, Trump, Le Pen et d’autres s’y engouffrent. « La perte de repères des classes populaires, le sentiment que la société de classes, où l’on a une place, a été détruite, laissant chacun perdu au sein d’une masse déstructurée », cette sorte « d’anomie néolibérale » pour paraphraser Durkheim, expliquent le succès des anti-systèmes. Les classes populaires ont perdu confiance dans les valeurs méritocratiques, tant et si bien qu’elles ne croient même plus que l’Etat puisse leur venir en aide. D’où leur revendication d’une « protection sans redistribution » et leur souhait d’ériger des murs.
Quelle croissance dans un monde numérisé ?
Puisque les difficultés économiques expliquent en grande partie le mal de vivre des classes populaires et son dérivé politique, le populisme, la question est désormais de savoir si les rémunérations des travailleurs de la société digitale vont se remettre à grimper. Avec un problème : les emplois dans les services à la personne ne permettent pas de faire des économies d’échelle et sont donc mal rémunérés. Tandis que les entreprises stars comme Apple, Google ou Facebook emploient peu de personnels très bien payés, la société semble de plus en plus prendre la forme d’un sablier, signe d’une atrophie de la classe moyenne.
Même si la technologie est porteuse de promesses, une société plus solide ne pourra se constituer sans institutions politiques nouvelles permettant aux individus de donner du sens à ce nouveau monde digital. C’est pourquoi Daniel Cohen plaide pour une « nouvelle sécurité sociale professionnelle », des syndicats forts à l’heure où les algorithmes employeurs comme Uber rendent toute grève quasi-impossible, et un revenu universel pour permettre à chacun de s’épanouir dans cette société digitale. Il s’agit finalement de « domestiquer » les forces du marché à l’époque du numérique. Les humains ont bien réussi au cours des deux derniers siècles à organiser une société vivable. Il n’y a aucune raison qu’ils n’y arrivent pas au XXIe siècle.
«Il faut dire que les temps ont changé », Daniel Cohen, Albin Michel, 19 euros.
Guillaume de Calignon